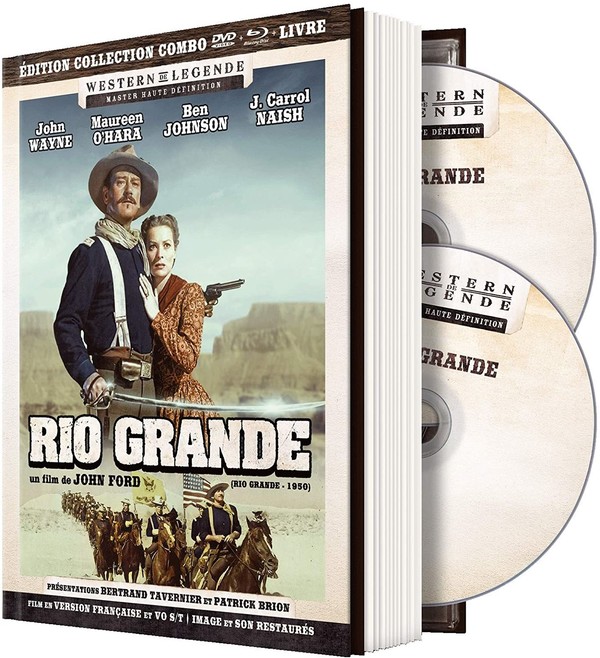La 6e Compagnie Parachutiste d’Infanterie de Marine (CPIMa) a participé à onze combats importants au Tchad de septembre 1969 à février 1972, y déplorant 26 tués et 50 blessés pour 540 combattants ennemis mis hors de combat. Elle reste à ce jour l’unité élémentaire française qui a le plus combattu depuis la fin de la guerre d’Algérie et constitue toujours un modèle d’emploi de l’infanterie légère.
Constitution d’une unité originale
L’opération Limousin est lancée à l’été 1969 afin de soutenir l’État tchadien très menacé par le Front de libération nationale (Frolinat). La 6e CPIMa est alors déjà sur place, associé au 6e escadron blindé au sein du 6e Régiment d’infanterie de marine d’Outre-mer (RIAOM). Formé d’appelés volontaires service long Outre-mer (VLSOM), le 6e RIAOM est à Fort-Lamy (N’Djamena) depuis 1965 où il sert d’unité d’intervention immédiate et de cadre pour l’engagement du dispositif Guépard avec un équipement prépositionné pour 390 hommes de plus.
En août 1968, devant le développement rapide de la menace du Front de libération nationale (Frolinat) soutenu par le Soudan et surtout la Libye, le Tchad fait appel une première fois à la France pour dégager le poste de Zouar menacé par des rebelles Toubous dans le Tibesti. La CPIMa est ainsi engagée après un aérotransport à Bardaï au nord de Zouar. Le poste est dégagé sans combat et l’opération est rapidement démontée.
La situation continue cependant à se dégrader rapidement et le Frolinat s’implante solidement à la fois dans les provinces peuplées du sud-est du pays et dans les trois provinces désertiques du Nord : Borkou, Ennedi, Tibesti ou BET. Au bord de l’effondrement, le gouvernement tchadien fait appel à la France qui décide d’engager le 2e Régiment étranger de parachutistes (REP). Le 2e REP est déployé dans le sud. Le 6e RIAOM devient alors l’unité d’intervention pour l’ensemble du théâtre. La CPIMa avait déjà été engagée durement avec ses VSL au Gabon en 1965 pour libérer le président M’Ba. On décide pourtant cette fois de ne plus engager de VSL au combat et de professionnaliser à partir de septembre 1969 tout le RIAOM grâce à des engagements de VSLOM sur place et surtout des mutations individuelles de marsouins et de cadres venus de métropole. Le 3e Régiment d’infanterie de marine (RIMa) sera également professionnalisé quelques mois plus tard pour relever le 2e REP. C’est le début de la réextension des unités de métier dans l’armée de Terre.
La CPIMa est alors formée d’une section de commandement (avec un groupe d’appui armé de 2 mortiers de 81 mm et d’un canon de 57 mm sans recul de l’armée tchadienne) et de trois, quatre à partir du début de 1970, sections d’infanterie légère, baptisées commandos. L’ensemble représente 180 hommes à son maximum.
Le dispositif français est si léger et son engagement si intense (on compte 40 opérations différentes pour la seule année 1970) que la CPIMa est employée de manière quasi permanente pendant deux ans, le plus souvent dans le BET dans des missions de dégagement des postes de l’armée nationale tchadienne (ANT) ou de recherche des bandes rebelles dans les palmeraies.
Les opérations dans le BET, dont la première a lieu le 7 septembre 1969, sont presque toujours lancées à partir de la base de Faya-Largeau qui accueille un État-major tactique, un détachement d’intervention héliporté (DIH) et une ou deux patrouilles de Skyraider AD4. Les avions de transport tactique, Nord 2501 et Transall, peuvent également se poser dans 5 autres aérodromes aménagés (Bardaï, Ounianga-Kébir, Zouar), ou « naturels » (grandes plaques de basalte) qui servent de base avancée. Par ailleurs, tous les postes de l’ANT disposent d’une piste sommaire pour avions légers et hélicoptères et servent de plots de ravitaillement en carburant.
À partir de ce maillage, le mode d’action privilégié consiste à l’aérotransport de la compagnie jusqu’à Faya-Largeau ou une des bases avancées suivi d’un raid héliporté ou motorisé (camions Dodge 6 x 6 ou parfois camions civils réquisitionnés).
L’objectif est alors bouclé et pris d’assaut, toujours avec l’appui d’un hélicoptère H 34 Pirate et d’au moins deux AD4. Le bouclage, même par héliportage, prend de deux à trois heures et la réduction de la résistance au moins le double. Si le combat n’est pas terminé avant la tombée de la nuit (vers 18 h), une mission d’éclairement par les fusées N 2501 Luciole doit permettre de fixer l’ennemi avant sa destruction finale le lendemain. Le pion d’emploi dans le BET est la compagnie complète, ce qui correspond au volume moyen de l’ennemi rencontré. L’armement est sensiblement équivalent des deux côtés, avec un léger avantage du trinôme FSA 49/56 -AA52-PM sur les fusils Enfield 303, carabines Stati et les quelques mitrailleuses légères Bren ou Lewis des rebelles. Si les parachutistes savent bien manœuvrer, les rebelles toubous connaissent le terrain et sont des rudes combattants qui ne s’enfuient pas et se constituent rarement prisonniers. Grâce à l’appui aérien, l’écart de gamme tactique en faveur des Français sur les points de contact est de l’ordre de deux dans le nord et de trois dans le sud.
Les premières opérations dans le BET et l’embuscade de Bedo
Les opérations de recherche et destruction dans le BET s’étalent de septembre 1969 à juin 1971. Parmi les plus importantes on peut distinguer Ephémère, dont l’objectif est de reprendre le poste d’Ounianga-Kebir dans le Borkou et d’y détruire la bande rebelle ainsi que celle de Gourou. La CPIMa est aérotransportée par Nord 2501 à Gouro et le 24 mars 1970 rejoint Ounianga-Kebir en véhicules, en même temps qu’une compagnie du REP. L’assaut de la cuvette est donné avec un très fort appui aérien. Les rebelles se replient, mais sont à nouveau accrochés par la CPIMa le 27. Le poste est repris, 84 rebelles sont tués et 28 autres prisonniers au prix de 5 parachutistes tués et de 9 blessés.
Durant le mois d’octobre 1970, la CPIMa est engagée dans le nettoyage de la ligne de palmeraies qui s’étalent entre 50 et 120 km au nord de Faya-Largeau et dont on sait qu’elles servent fréquemment de refuges aux bandes rebelles. Le 9 octobre, la compagnie forte de trois commandos et d’une section de commandement et d’appui (avec un canon de 53 sans recul et de deux mortiers de 81 mm), portée sur 15 camions Dodge 6 x 6, reconnaît l’axe de Kirdimi à Tagui. Après une nuit placée en embuscades dans les environs, l’unité se replie sur Faya-Largeau, toujours sans avoir rencontré l’ennemi.
À 16 h 30, à mi-chemin entre Bedo et Kirdimi la compagnie longe un mouvement de terrain sablonneux et rocheux lorsqu’un feu nourri stoppe la section de tête et fixe l’unité sur un kilomètre de long. L’unité est surprise, car le terrain n’est pas propice à une embuscade. Elle est surprise une deuxième fois par la puissance de feu de l’ennemi, estimé à un peu plus d’une centaine de combattants, qui dispose de plusieurs mitrailleuses légères Bren ou Lewis. Les forces sont équilibrées, mais les rebelles bénéficient de l’initiative du combat et de la position. La section de commandement ne parvient pas à établir le contact avec Faya-Largeau pour obtenir un appui aérien. La situation est finalement renversée par le 4e commando en queue de colonne et hors de la nasse. Le commando remonte le mouvement de terrain où sont postés les rebelles et dégage le 3e commando puis la section de commandement qui peut mettre en batterie son canon de 57 mm SR. Il leur faut deux heures pour parvenir à dégager le commando de tête qui a subi la majorité des pertes.
La nuit tombe et un vent de sable se lève. La CPIMa qui craint une nouvelle attaque ennemie s’installe en position défensive, éclairée par les fusées larguées pendant des heures par un Nord 2501, tandis qu’un équipage d’Alouette II (sous-lieutenant Koszela) guidé par un AD4 brave le sable et la nuit à plusieurs reprises pour évacuer onze blessés graves sur douze. Au lever du jour, la compagnie nettoie les environs et trouve 30 cadavres. Par la suite, les tombes retrouvées dans le secteur et les interrogatoires de prisonniers permettent de déterminer que la bande rebelle a presque été entièrement détruite.
Les pertes françaises s’élèvent à 11 morts et 25 blessés dont un décédera par la suite. Deux heures de combat ont donc suffi pour provoquer presque un tiers des pertes françaises des trois ans de guerre.
L’évènement provoque une grande émotion en France et un violent débat politique. Preuve est ainsi faite qu’une erreur tactique ennemie peut constituer pour lui un succès stratégique dès lors qu’il est parvenu à tuer plus de 5 hommes dans un seul engagement. Dans l’absolu, seize ans seulement après la bataille de Diên Biên Phu, les pertes du combat de Bedo sont faibles. Elles représentent même les pertes moyennes d’une seule journée des huit ans de la guerre d’Algérie. Elles sont cependant suffisantes pour attirer l’attention des médias sur un engagement que l’on souhaitait garder peu visible et susciter un vif débat politique qui ne manque pas d’influer sur la suite des opérations.
L’échec de Bison et la sécurisation du sud
L’opération Bison, qui est lancée en janvier 1971, est la plus ambitieuse lancée dans le BET puisque c’est l’ensemble du 6e RIAOM, renforcé d’une compagnie du 3e RIMa, qui est engagé pour deux mois. La base de Faya-Largeau a reçu pour l’occasion le renfort d’une deuxième patrouille de Skyraider AD4 et de l’escadrille 33F de l’aéronavale forte de 12 h 34 (transportés à Douala par porte-avions). L’opération se déroule en trois phases du 10 janvier au 15 mars. La première-Bison Alpha-a pour objet de nettoyer la région de Bedo. La CPIMa s’emploie à reconnaître toute la zone du 11 au 18 janvier mais n’y rencontre pas l’ennemi. La troisième-Bison Charlie - se déroule du 9 février au 10 mars (mais est interrompue du 12 au 19 février pour faciliter des négociations en cours) dans la région de Bardaï. C’est l’escadron qui y est principalement engagé et il ne rencontre pas non plus l’ennemi.
Bison bravo, qui se déroule du 21 au 27 janvier dans la région de Gouro est la seule à avoir occasionné un combat. Elle est déclenchée à la suite d’un renseignement fourni par un rebelle rallié, confirmé par photo aérienne, décrivant la présence d’une bande rebelle d’une cinquantaine de combattants à Moyounga entre les palmeraies de Bini Erda et Bini Drosso à 70 km au nord-ouest de Gouro.
La première phase consiste en la mise en place d’une base avancée sur une immense plaque de basalte au sud de Gouro, sécurisée dans la nuit du 21 au 22 janvier par une section de l’ANT puis par un commando héliporté après un arrêt et un ravitaillement au poste d’Ounianga-Kebir. À 7 h, deux Transall se posent sur la piste avec les 4 commandos ainsi qu’un H34 Pirate et 8 h 34 cargo volant à vide (condition nécessaire pour atteindre directement Gouro). Les Transall retournent à Faya-Largeau pour récupérer 2 sections du 3e RIMa et du carburant. Une fois les pleins effectués, l’Alouette II, qui sert de PC volant et les H34 avec deux commandos à bord partent vers l’objectif, première des trois rotations qui vont se succéder toutes les deux heures.
En cours de vol de la première rotation, le rebelle rallié désigne un emplacement de l’ennemi différent de l’objectif initial. Le commandant de l’opération décide de modifier le plan de vol, mais la saturation du réseau radio empêche tous les groupes d’apprendre qu’ils vont être déposés au plus près de l’ennemi. L’un d’entre eux est ainsi surpris par le feu ennemi et le sergent-chef Cortadellas, fils du général COMANFOR, est tué. Les AD-4, qui étaient en attente à 30 km au sud interviennent. À 13 h 30, le bouclage est terminé avec l’arrivée des deux sections du 3e RIMa. L’ennemi est particulièrement bien retranché et résiste toute la journée. Un deuxième marsouin-parachutiste est tué. L’hélicoptère Pirate est touché et obligé de se poser. Le bouclage est maintenu dans la nuit, mais le Nord 2501 Luciole chargé d’éclairer la zone arrive bien après la tombée de la nuit, ce qui a laissé le temps à l’ennemi de se replier dans le relief tourmenté. Au matin du 23, la fouille des lieux permet de découvrir 11 cadavres ennemis et le survol de la zone permet de faire trois prisonniers. Le dispositif est replié sur Faya-Largeau en fin de journée.
L’opération Bison est un échec avec quatre soldats tués, dont deux par accident, et 37 blessés dont 10 évacués sur Fort Lamy, pour un effet sur l’ennemi très faible.
La dernière grande opération de recherche et destruction dans le BET a lieu du 17 au 19 juin 1971 à Kouroudi à 100 km au nord de Faya-Largeau. La CPIMa se déplace jusqu’à Bedo en véhicules où elle est récupérée par H34 et héliportée en bouclage autour d’une bande rebelle de 150 hommes. L’opération est parfaitement coordonnée jusqu’à la tombée de la nuit, qui, du fait du retard de l’arrivée de la mission Luciole, permet aux rebelles de s’exfiltrer laissant néanmoins sur place 55 morts pour aucune perte française.
Le commandement français décide alors de renoncer à ces opérations de recherche et destruction dans le BET, considérées comme assez vaines, pour se concentrer sur le « Tchad utile » au sud du 15e parallèle. La CPIMa n’est plus engagée dans le Nord qu’en protection des grandes missions logistiques qui sont montées pour ravitailler les postes de l’ANT par voie routière (opération Morvan en octobre 1971 et Ratier en février 1972).
La CPIMa est alors engagée dans le sud et l’est du pays, zone plus peuplée, où, en liaison avec l’ANT et le 3e RIMa, elle mène des opérations de nomadisation plus longues et plus décentralisées. En février 1972, l’opération Languedoc dure plus d’un mois et permet à la CPIMa d’éliminer une bande rebelle de 200 hommes venue du Soudan, en lui infligeant 49 morts et 7 prisonniers pour aucune perte française. C’est la dernière grande opération de la compagnie.
Enseignements tactiques
Il apparaît tout d’abord que les pertes françaises surviennent surtout lorsque l’ennemi bénéficie de l’initiative et de la surprise, ce qui est le cas lors de l’embuscade de Bedo mais aussi lors de plusieurs prises de contact, en particulier lorsque l’unité est motorisée. Dès que les parachutistes peuvent manœuvrer et surtout s’ils ont l’initiative des combats, ce qui survient presque toujours lors des opérations héliportées, le rapport de pertes est beaucoup plus favorable.
À Bedo, malgré la surprise et sans bénéficier d’appuis feux aériens, les hommes de la CPIMa finissent par infliger aux rebelles des pertes très supérieures aux leurs grâce à leur qualité propre. Le capital de compétences de cette unité qui mène une campagne ininterrompue de trois ans ne cessera pas d’augmenter face à des unités ennemies qui combattent moins. Le rapport des pertes est par ailleurs de plus en plus favorable aux Français avec le temps.
L’efficacité de la CPIMa, comme celle de toutes les autres unités engagées sur place, aurait pu accrue en les dotant de fusils d’assaut, des Fusil Automatique Léger (FAL) par exemple. On ne se résoudra à acheter des fusils d’assaut étrangers qu’en 1978 lorsque les forces en face en seront dotées.
Jusqu’à Bedo, la CPIMa était très dépendante de l’appui aérien. Ceux-ci étaient très efficaces, ils l’auraient été encore plus en adoptant l’équivalent des Gunship américains alors en expérimentation au Vietnam. Des essais avec le Nord 2501 se sont avérés très décevants, mais le C 160 Transall, dont c’était le premier engagement, aurait peut-être pu être adapté dans ce sens.
L’appui aérien dépendait cependant des conditions météorologiques et des liaisons radio. Il n’était pas par ailleurs immédiatement disponible en cas d’attaque ennemie. Il était nécessaire d’internaliser des appuis puissants. La compagnie disposait de deux mortiers de 81 mm, difficiles à utiliser en cas d’imbrication. Il manquait un peloton de véhicules blindés-canon, au moins d’AML 60. L’escadron blindé du 6e RIAOM utilisait alors des automitrailleuses Ferret, faiblement armé. Un peloton de Ferret aurait cependant été très utile à Bedo en ouverture d’itinéraire. Ce sera dès lors souvent le cas.
Un autre enseignement de l’embuscade de Bedo est la nécessité de se déployer dans un volume au moins équivalent à celui de l’ennemi, tout en s’efforçant de maintenir un dispositif assez large pour conserver quoiqu’il arrive une possibilité de manœuvre. À Bedo, la colonne motorisée est suffisamment longue (2 km) pour ne pouvoir jamais être totalement prise dans une embuscade. Il y a toujours au moins un commando qui reste capable de manœuvrer et de prendre l’ascendant sur l’ennemi. Dans le sud, les commandos sont souvent employés de manière dispersée, mais face à un adversaire de moindre qualité qu’au nord ils ont la capacité de résister en contact jusqu’à l’arrivée rapide du reste de l’unité et des appuis aériens.
Enseignements opératifs
La coopération interarmées a été la clef du succès des opérations dans le BET. Dans tous les domaines, l’action de l’armée de l’air (et de l’aéronavale) a été déterminante en raison de l’immensité des zones à contrôler et l’absence de végétation.
Dans les grands espaces du Nord et alors que l’ennemi ne dispose pas de moyens antiaériens efficaces, les raids héliportés se sont avérés évidemment plus rapides et finalement moins vulnérables que les raids motorisés. Les moyens de transport aéromobiles ont cependant été insuffisants pour faire face à tous les besoins. L’acquisition de quelques hélicoptères lourds existants à l’époque, comme le CH-46 D, ou même l'utilisation de Super Frelon français aurait encore plus permis de réduire les délais d’héliportage, voire d’engager simultanément deux unités élémentaires.
Ce mode d’action présentait cependant l’inconvénient d’être complexe et donc vulnérable à tout élément inattendu (défaillance des transmissions, tempêtes de sable, erreurs topographiques). Avec le temps, le réseau radio (la CPIMa utilisait la technologie TRPP 13 alors que les aéronefs utilisaient la génération AN/PRC-10) a été rendu plus redondant et plus diversifié (le réseau appui a été séparé du réseau transport), ce qui a nettement réduit la friction.
Tous les types de raids présentaient également l’inconvénient de dépendre entièrement du renseignement, beaucoup plus rares dans les zones hostiles du Nord que dans les provinces plus peuplées et rapidement plus favorables du Sud.
Enfin et surtout, autant l’approche globale dans le Sud (réforme de l’administration sou contrôle de la force française, unités de combat franco-tchadiennes, nomadisation des unités du 2e REP et du 3e RIMa) a donné d’excellents résultats, autant la conjonction de la tenue des points clefs et de nettoyage régulier des palmeraies par des raids s’est avérée stérile sur le long terme. Les populations du Nord sont toujours restées favorables à la rébellion et, avec l’aide de la Libye comme base arrière, lui ont toujours permis de reconstituer ses forces. À partir de juin 1971, on s’est contenté de les contenir et de préserver les résultats obtenus dans le Tchad utile.
Source